ECOLE, MEMOIRE ET IDENTITE NATIONALE EN FRANCE: QUAND LES MINORITES QUESTIONNENT LE PACTE REPUBLICAIN
Aннотация
La nécessité d’ «enseigner la Nation» dans l’un des rares pays, la France, où l’éducation est nationale renvoie à une histoire dans laquelle l’Ecole moderne est d’abord « affaire d’Etat » depuis plus d’un siècle, tout en revendiquant depuis la seconde de modernité sa neutralité politique, par un curieux paradoxe au cœur même de notre histoire. Le Cahier des charges de la Formation des Maîtres [1], document qui précise le cadre et le contenu de la formation de tous les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire précise dans sa 1ère compétence intitulée «agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable» que «le professeur connaît les valeurs de la République et les textes qui les fondent: liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes» et qu’il doit «faire comprendre et partager les valeurs de la République». Ce parti-pris est fondamentalement politique, celui d’inculquer par la haut des principes et valeurs supposées transcendantes. Pour saisir les enjeux contemporains de cette interrogation « faut-il, peut-on enseigner la Nation et construire une mémoire nationale commune ?», un détour historique s’impose pour aborder la «question scolaire» et plus largement les modalités de construction de notre « vouloir-vivre » collectif.
1. L’Ecole, une affaire d’Etat ? ou l’impératif de neutralité à l’épreuve de l’institution
Dans notre histoire politique, la contribution de l'État moderne à la naissance du citoyen passe par un instrument idéologique d’inculcation des valeurs communes : l’Ecole. Si l’Etat joue sa pérennité dans la formation du citoyen, l’éducation fut à la fois lieu et moment d’un choix politique par l’invention de l’Ecole républicaine et l’instrument de construction d’une mémoire collective comme d‘une culture commune aujourd’hui révoquées en doute. L’invention de l’Ecole républicaine est partie prenante d’un projet de citoyenneté collective, qui revendique la neutralité politique.
1.1. L’ invention de l’Ecole républicaine.
En France, la construction d’une citoyenneté totalisante constitue une exception celle du modèle républicain moniste. La citoyenneté est un artefact culturel naturalisé qui engendre l’allégeance du citoyen à la Cité et impose l’universalité de la Raison. L’idée de citoyenneté nationale fondée sur le Contrat, héritière des théories d’inspiration rousseauiste du pacte social volontariste, inscrit le sujet citoyen dans une appartenance collective, moment de perpétuation des liens sacrés des individus au Tout. Principe d’allégeance à un État, mais aussi sentiment d’appartenance, la nationalité n’est pas tant un mode de construction d’une identité culturelle qu’une identité politique naturalisée. Transfigurée par son assimilation à l’idéologie de construction de l’État-Nation, elle est devenue le seul accès politiquement et socialement reconnu comme légitime aux droits politiques et sociaux, et donc à la citoyenneté. Seul le citoyen est sujet de droits, citoyen abstrait dans l’unité abstraite qu’incarne la République [2] supposée mettre en acte une méritocratie fondée sur la Raison et les vertus du travail. Unifiée et centralisée plus tôt que la plupart des autres États européens, la France fut plus radicalement sécularisée et laïcisée et développa des concepts novateurs comme les Droits de l’homme et du citoyen liés à l’équation État = Nation = Peuple, faisant de la Loi un paradigme universel. Le citoyen y devint l’homme d’un seul État, d’une seule foi, le républicanisme laïc et égalitaire, d’une seule idéologie, celle des Droits de l’homme. Le citoyen abstrait n’a ni âge, ni sexe, ni origine sociale, ni origine ethnique. Ce que l’universalité des valeurs de la bourgeoisie conforte dans l’instant de la création citoyenne, c’est la part unique et nécessaire d’une culture de la Raison. La Nation-peuple, falsifiée en État-Nation, va perpétuer l’Ancien Régime par le paradoxe d’une laïcité sacralisée. Les manuels d’histoire de Lavisse, endoctrinant les enfants, en ont d’ailleurs été l’expression caricaturale. La République française moniste construit donc une solution originale, supposant l’allégeance des périphéries au centre. La centralité revendiquée de la citoyenneté dans le cas français conduit aujourd’hui encore non seulement à une sous-estimation de la vitalité des appartenances singulières et collectives, mais aussi à la construction d’un habitus nationaliste républicain tendant à mettre hors-jeu tout autre mode d’identification.
Mue par une philosophie de l’Un, la citoyenneté réduit « l’Autre au Même ». La citoyenneté relègue les solidarités mécaniques à la sphère du culturel et non du politique, à la sphère de l’intimité et non du public. En tant que déni des allégeances particulières, qu’elles soient infra ou supranationales d’une part ,ou économiques et sociales d’autre part, la citoyenneté est alors ce projet politique fondateur, qui construit un sujet politique unidimensionnel. L’émancipation du citoyen, la naissance du citoyen se construit avec les savoirs et avec la promotion d’une « conscience citoyenne ». Tout citoyen doit être capable de prendre quelque distance intellectuelle avec son groupe d’appartenance. C’est pourquoi le citoyen est par essence une abstraction construite et intériorisée par le plus grand nombre grâce à l’Ecole républicaine. L’analyse de Florence Giust-Desprayries sur « la figure de l’Autre dans l'école»[6], montre que cette généalogie n’est pas sans effet sur les imaginaires et pratiques des enseignants d’aujourd’hui : le modèle républicain articulé autour des idées d’universalisme et d’abstraction induit chez les enseignants des modes de défense, notamment en termes de représentations qui les empêchent d'accepter les élèves tels qu’ils sont. Le sujet, (et dit-elle particulièrement le sujet enseignant) intériorise des représentations sociales jusqu’au moment où celles-ci tellement éloignées de la réalité, ne peuvent plus jouer leur rôle d’étayage psychique, d’où une sidération de l’imaginaire. L’imaginaire républicain est dans la culture scolaire ce qui sert d’étayage aux enseignants au détriment de l’histoire des sujets. Il conduit à faire l’économie d’une réflexion sur l’ensemble des protagonistes de l’institution. Les enseignants deviennent les serviteurs d’une légitimité qui les dépasse auprès d’un public non différencié. Cette croyance renforce les difficultés des enseignants à trouver des solutions qu’ils souhaiteraient universelles, mus qu’ils sont par des « attentes magiques », selon l’expression de l’auteur, qui les poussent à nier l’altérité dans l’ici et maintenant des situations scolaires. Les enseignants perçoivent alors l'identité comme « compacte » et non dynamique. L‘impossibilité à trouver du sens dans les situations réelles les conduit à maintenir cette illusion au prix de l’exclusion des élèves considérés comme atypiques, à moins qu’ils ne soient justement les représentants les plus typiques de ce que l’inconscient des adultes cherche à refouler. Reprenant l'analyse de Freud dans Malaise dans la civilisation, elle explique que cette illusion, certes nécessaire pour pouvoir investir les objets, fait néanmoins obstacle à la prise en compte de l'objet réel. Dans une société connaissant une accélération des processus d’identité, les scénari construits sur un idéal de maîtrise ne peuvent alors perdurer et la tentation de l’emprise, qui nie l’autre dans son altérité comme sujet peut alors venir combler cette absence de maîtrise. Pour endiguer ces angoisses, l’Ecole édifie plusieurs formes de contrôles tendant à soumettre les membres de l’organisation à son idéal commun de laïcité et d’égalité des chances et d’idée nationale re-construite aux fins de produire une identité commune par l’Ecole.
1.2. La raison comme et la Citoyenneté comme compétence.
C’est donc l’instruction qui fera le citoyen. Dans son projet historique, l’École en articulation étroite avec la République (dans sa relecture par la IIIème République) se construit sur l’intégration de tous dans une unité fondatrice émancipant l’individu par l’instauration d’un savoir commun. La raison individuelle s’éduque, se discipline par l’exercice de savoirs scolaires. La pensée individuelle s’exerce sur un obstacle abstrait qui porte en lui la nécessité de sa propre cohérence, le savoir. Si la République édifie l’école comme moyen de sa perpétuation, c’est au travers de sa prétention proprement politique à rythmer espace et temps, faisant abstraction des particularismes locaux et sociaux, par son action centralisatrice et rationalisante. L’État est le garant de la constitution des idéaux collectifs par ses appareils idéologiques ; l’École est affaire de citoyenneté construisant unité nationale et consensus social. Pour Mona Ozouf [8], l’efficacité de l’École républicaine a tenu à l’intériorisation de la règle d’or de Jules Ferry: silence sur tout ce qui divise ou pourrait diviser. Solution à l’unité de la diversité, l’École de la République travaille à la construction d’une civilité fondée en Raison, au point que les instructions officielles affirment aujourd’hui encore: « on naît citoyen, on devient un citoyen éclairé » ; exprimant ainsi la mission civilisatrice de l’École.
En France, c’est la République qui a reçu mission de construire un savoir scolaire articulant une certaine vision de la scientificité et du savoir savant aux vertus civiques. Le savoir se modèle et modèle un projet politique unitaire.. Selon Condorcet, en matière d’instruction publique, tolérer une erreur, ce serait s’en rendre complice ; ne pas consacrer hautement la vérité, ce serait la trahir. L’instruction ne peut appartenir qu’à la vérité seule. Elle doit lui appartenir toute entière. L’éducation à la science anticipe sur cet homme en devenir. Dans notre ordre juridique, la citoyenneté est donc un acte volontaire qui soumet le particulier à l’universel, rattachant l’individu à une civilité policée par l’accès à la culture entendue comme moyen de civiliser le naturel dans l’homme, à la condition que le travail des apprentissages sociaux et politiques transcendent les contingences biologiques et sociales. Cette éthique de la Raison est « autocréation sociale d’un citoyen » éclairé selon l’expression de Jean Lombard devenant maître et possesseur de la Nature et de l’Humanité par cet accès institutionnalisé au savoir. L’École se justifie dans l’exigence d’une citoyenneté éclairée. Le vivre ensemble de la citoyenneté appelle deux vertus antinomiques : tour à tour obéir et résister. La gestion de ce paradoxe justifie la nécessité de socialiser les futurs citoyens autour de deux exigences : la discipline de soi et la culture policée du rapport à l’Autre civilisé. La force de l’École dans sa fabrication de l’universalisme abstrait citoyen réside dans l’exercice régulier d’une discipline de soi. Le rapport au savoir est fondé sur un rapport au vrai. Les élèves sont soumis dans ce rapport au savoir comme les citoyens vis-à-vis de la loi et comme les enseignants eux-mêmes.
Cependant, derrière l’identité, apprendre c’est nier son inscription empirique particulière, c’est faire l’expérience de l’altérité, se risquer à autrui... s’il est la figure du Même. L’École productrice de valeurs centrales de cohésion sociale participe à la production et à la reproduction du citoyen par la socialisation méthodique de la jeune génération, selon l’expression de Durkheim. Le projet fondateur de l’École de la République est la construction d’un système scolaire, homogène et homogénéisant les différents milieux d’appartenance sociales, sexuelles, ethniques, régionales, idéologiques et singulières des acteurs, dans un lieu de savoir, par delà la concurrence des autres lieux supposés exogènes. La politique scolaire de la troisième République fondant l’unité de la Nation autour de l’idéologie républicaine inaugure l’entrée dans l’ère de l’État éducateur. Elle s’appuie sur trois principes: l’égalité de tous les enfants devant l’École, le droit de tous à l’éducation et le devoir de l’État d’assurer un enseignement diffusant des valeurs et une morale communes. L’État éducateur initié par Jules Ferry dans le primaire inculque à la jeunesse la Morale naturelle et dans le secondaire les Humanités. Cette Morale naturelle est une conquête de la maîtrise de soi et du contrôle de la Raison sur les désirs. L’uniformité par la négation des milieux qu’assure la centralisation doit renforcer l’unité nationale. L’École reçoit la fonction d’abolir les particularismes et notamment les particularismes locaux, que ce soit par l’imposition du français face aux patois encore usuels dans la vie courante, par l’imposition du système métrique face aux mesures locales (corde, pousse, toise), du franc comme mesure des prix face aux louis et aux écus, ou encore, par le refus d’un enseignement de l’histoire ou de la géographie locales, afin de modeler une conscience collective nationale par delà les résistances. Comme le montrent les travaux de Vermes [13], du fait de l’institutionnalisation de la langue, projet de la Révolution française et dont l’école est porteuse, les enseignants participent très largement de l’idéal du monolinguisme. Depuis la Révolution française leur représentation dominante est dans la nature du français d’être Français et dans la nature du français de ne parler que français. Pour Eugen Weber dans La fin des terroirs, l’école et particulièrement l’école du village, gratuite et obligatoire s’est vue attribuer le processus d’acculturation finale qui a transformé les français en français, qui finalement, les a civilisés. Les instituteurs, avec leurs vêtements sombres et usés, apparaissent comme la milice d’un âge nouveau, comme les porte-parole des Lumières et du message républicain qui réconcilie les masses ignorantes avec un monde nouveau, supérieur du point de vue du bien-être de la démocratie. En ce sens, une des principales batailles menées par l’État central au nom de l’idéologie républicaine est la laïcisation de l’institution, des savoirs, comme des consciences : nécessité à la fois politique, économique et morale. Si le projet fondateur de l’École de la République passe par la négation des milieux d’appartenance des élèves et des autres lieux concurrents de socialisation, c’est que l’École est ce facteur d’acculturation où l’instituteur institue la Nation. Selon Suzanne Citron, la francisation républicaine, qui fut essentiellement l’œuvre de l’école, fut une « nationalisation », une intériorisation de l’Etat Nation et de son « histoire » francophone, parisienne, monocentrée, ancrée dans l’immémorial gaulois. L’Ecole est donc bien affaire d’Etat.
1.3. Neutralité politique de l’Ecole et laïcité.
Contrairement à ce que véhiculent nos idéologies françaises centrales, l’espace public et l'espace privé ne sont pas étanches. Ce modèle se confond partiellement avec la conception républicaine, qui dans l’espace public et politique, fait prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, universalisme née des philosophies rousseauistes des Lumières. Parce que l'immanence républicaine de l'homme est un mythe, parce que la société républicaine est fragile et que la laïcité est une valeur à part entière, l'école républicaine a une fonction fondamentale à jouer dans la transmission des valeurs fondamentales qui l'animent et particulièrement la laïcité. Ce qui semble sceller le caractère politique de toute institution socialisante et spécifiquement l'école. La dimension politique semble curieusement « politiquement incorrecte » aux yeux des acteurs du monde scolaire. Ils refusent d’admettre que l’Ecole puisse être un lieu politique et par conséquent qu’un regard politologique puise être jeté sur son fonctionnement. Or, c'est justement le défi à relever que de comprendre quelles sont les implications de cette réticence collective à penser l’Ecole comme une Cité politique. Or, notre modèle est fondé aujourd’hui sur la revendication d’une neutralité politique de l’Ecole. Les représentations sociales ont connu un glissement sémantique assimilant neutralité non seulement religieuse mais politique de l'Ecole, voire de l'Etat. Or les représentations sociales en étiquetant le monde, orientent les pratiques sociales. La question de la neutralité politique de l'Etat républicain ne peut pas ne pas être posée. Dans le contexte de l'Etat moderne, les schémas moraux de la tradition ont perdu leur force. La sécurité ontologique, faiblement fondée s'appuie alors sur des routines sans signification morale. La communauté exprimée par les symboles nationaux fournit alors cette sécurité ontologique qui fait défaut, comme le montre Anthony Giddens. En tout état de cause, l'Etat nation doit produire sa continuité et l'assurance de sa continuité, par cet habitus national, selon l'expression d'Elias, suscitant ce sentiment national, image d’un Nous valorisant. Or, ce sentiment et cette idéologie de la communauté nationale ont une fonction cruciale dans l'architecture des institutions démocratiques. La valeur identitaire de l'Etat nation sert de socle à la légitimation des institutions politiques. Les institutions d'enseignement public sont donc orientées vers l'approfondissement et le renforcement d'un enseignement du Nous presque exclusivement axé sur la tradition nationale. Les récents débats sur la construction partiellement amnésique de la mémoire française dans et par l'Ecole en attestent. Ce n'est probablement qu'après mai 68, dans un climat « droitier » et d'imputation de « gauchisme » au corps enseignant, d'un fantasme d'endoctrinement politique des masses par l'école, qu'une circulaire de René Haby identifiant laïcité et neutralité politique scellera le glissement sémantique. Elle préconise une attitude objective « laïque », devant les problèmes religieux et politiques. L’Etat est chargé selon lui de par la délégation qui lui en est faite d’assurer une formation dans un champ limité et qui, de tradition laisse à l’écart tous les domaines controversés des connaissances et des modes de pensée dans lesquels ne peut être abandonné à l’Ecole en tant qu'organisme, à son administration, à un ou plusieurs enseignants, voire au groupe d'élèves, la responsabilité de définir les objectifs éducatifs. Cette inflexion n’était pas anodine. Elle participe au déni du politique dans le lieu scolaire ce qui nous permet alors d’appréhender autrement la question centrale de l’arbitraire de la règle scolaire. Socialisant les jeunes générations et inculquant les normes centrales permettant la cohésion sociétale. L’Ecole construit-elle une mémoire nationale fédératrice et donne-t-elle au plus grand nombre les ressources permettant de décrypter le jeu social ? Dans un processus de contractualisation social et politique de l’éducation d’une Nation unifiée, donc purifiée des scories des histoires singulières, se conçoit l’histoire politique de l’Ecole en France, institue et légitime tour à tour une vision eschatologique de la société française, par laquelle, le peuple est rendu pleinement souverain, sous l’éclairage généreux de la Raison, des lumières et de l’universalité conquérante des savoirs émancipateurs. Ce contrat est-il aujourd’hui caduc ? L’Ecole est aujourd’hui confrontée à des demandes de pluralismes culturels et cultuels auxquels elle doit faire face. Comment y répond-elle?
La construction sociale de l'identité nationale française passe par l’assignation à chaque individu d’une identité singulière et la production collective de référents identitaires, marqueurs culturels autant que politiques. L’Ecole en est un acteur de la définition de cette citoyenneté républicaine, comme système de représentations symboliques et sociales que l’inculcation d'une mémoire nationale promeut.
2. L’Ecole et la construction d’une mémoire nationale
Dans un fichier d'éducation civique encore aujourd'hui utilisé dans les écoles primaires, il faut répondre à des questions du type : quels traits de caractère attribue-t-on au coq ? Ou bien encore à la lecture d'un texte de celui-ci : comment Jules Ferry justifie-t-il la colonisation ? La réponse attendue, dictée par le professeur d’école est "apporter la civilisation aux pays colonisés", sans aucune distance critique sur le texte de Jules Ferry !!!! Suzanne Citron n'aurait pas osé aller jusque là, elle qui dans Le mythe national, L’histoire de France en question [2] retraçait l’histoire de l’affirmation de l’Ecole républicaine en tant que creuset de la Nation et que «conscience morale », mutilant la richesse multiple et contradictoire des mémoires françaises, par la promotion d’une «légende », consacrant une France immémoriale au travers de l’enseignement de l’histoire objectivement «patriotique », présentant une France une et indivisible.
2.1. L’Ecole et l’identité nationale
L’histoire de l’invention moderne de l’Ecole en tant qu’Institution de la socialisation démocratique est aussi celle de la construction/déconstruction/ reconstruction d’une mémoire collective. L'histoire de la mémoire est la question qui se pose à la modernité, autant comme marquage des traces du passé que comme forme symbolique de quête d'identification collective. L’École opère une sélection de savoirs et une organisation en séquences : la mise en discipline des savoirs sert le projet supérieur de mise en discipline de l’individu en conformité à l’ordre social existant et projeté. Cette fabrication scolaire et sociale de la mémoire nationale, notamment dans les enseignements historiques est un travail de reconstruction mettant en scène oubli et déni. Le pensable et le désirable sont toujours en partie modelés par les institutions qui nous façonnent. La mémoire collective sert de système de stockage à l’ordre social. L’oubli ne se fait donc pas au hasard : mémoire et oubli dépendent d’un système mnémonique constitué par l’ordre social. C’est pourquoi les institutions gouvernent et contrôlent la mémoire. Merton qui fondait émotions, cognition et structures sociales en un seul système, soulignait la faculté de tout ordre social de créer les conditions d’une myopie motivée par la dénégation d’une réalité douloureuse. Toute société a la dénégation à sa racine. En cela, l’Ecole, comme toute autre institution, est un lieu où s’enlise le sens, sous l’effet du pouvoir, par essence conservateur et par nature victime de l’entropie. La mémoire nationale scolaire est à la fois sélective et belligène. Elle se légitime car elle vise à garantir l’identité d’un groupe, sans pour autant y parvenir . Elle joue donc sur l’obsession du culte du souvenir. Elle nécessite de naturaliser le réel par la promotion « d’allants de soi ». La mémoire collective en produisant le groupe, produit aussi la société et la contre-société.. Penser la mémoire est alors penser le rapport à l’histoire, au sens où la mémoire est une mémoire vécue, sans cesse inscrite dans le politique et dans une temporalité qui lui est spécifique. Et, c’est en tant qu’espace de narration que l’Ecole est partie prenante du discours collectif qu’est la mémoire commune. Dans son ouvrage, Le mythe national, L’histoire de France en question, Suzanne Citron retrace l’histoire de l’affirmation de l’Ecole républicaine en tant que creuset de la Nation et que conscience morale, mutilant la richesse multiple et contradictoire des mémoires françaises, par la promotion d’une légende, consacrant une France immémoriale au travers de l’enseignement de l’histoire objectivement « patriotique », présentant une France une et indivisible. Selon Citron, l’historien Ernest Lavisse a fixé pour les écoles, un TEXTE du passé, organisé autour d’une France sans commencement incarnée dans une Gaule mythique, d’une succession d’actes de guerre et de conquêtes licites puisqu’ils construisaient une patrie préexistant à sa formation. Les abus de pouvoir servant la grandeur et l’unité de l’Etat sont ainsi légitimés. Cette histoire inventée par l’Ecole servira alors de « catéchisme » à la religion de la France, lieu imaginaire de la révélation de Dieu dans la patrie, lieu du récit de la présentation d’un passé mis en ordre et épuré. Une théologie intégriste de la France est prolongée par une morale intégriste. La patrie est source de morale et le service de la France impose de (re)construire une mémoire collective et historique, garante de la fusion des milieux en un lieu homogénéisant et réducteur. Cette mise en scène du passé, inaugurée dans les manuels d’histoire de la IIIème République est récurrente dans l’Ecole en France. L’essence de la France continue encore d’y précéder l’existence de chaque français. L’histoire de chaque français ne peut être que celle de la France. L’école républicaine fut une entreprise d’alphabétisation et d’égalisation méritocratique mais aussi une machine à acculturer en réduisant ou éliminant ce que la France de la fin du XIXème siècle conservait encore comme différences de culture et de langage. Suzanne Citron insiste particulièrement sur ces « trous de mémoire » que représentent Vichy et la guerre d’Algérie, représentatifs des gommages, censures et traductions légendaires de notre histoire dans l’enseignement. Elle y voit les séquelles de l’Etat monarchique dans la République et la preuve d’une manipulation de la mémoire collective par les élites au bénéfice des différents pouvoirs. Car la logique de cette histoire est de légitimer le pouvoir en place, le « vainqueur » et d’ignorer les vaincus Il s’agit d’une mémoire excluante, qui repose sur la négation de l’Autre. Son caractère est d’être totalitaire et linéaire. Elle a pour finalité d’assurer au groupe qui s’en réclame, un droit exclusif et sacré, celui d’appartenir à l’entité nationale, par cette allégeance politique à une mémoire reconstruite qui repose sur l’ignorance, parfois la suspicion et la haine des autres. Cette mémoire excluante cache les enjeux de pouvoir. Elle exclut donc tout projet de mémoire existentielle, critique et plurielle. C’est pourquoi, Citron invite à réinventer l’histoire à l’Ecole, une histoire qui cesserait d’avoir pour seule logique le processus de construction de l’Etat Nation.
Dés le XIXème siècle l’école devient un instrument privilégié pour développer le sentiment d’appartenance nationale, notamment grâce par la langue, à la littérature, aux enseignements d’histoire, géographie et instruction puis l’éducation civique, destinés à construire un socle de valeurs communes, véhiculant des certitudes, formant une identité nationale commune[3]. Une instruction ministérielle du 4 juillet 1961 rappelle que l’éducation civique doit préparer les citoyens au « sacrifice suprême » pour la patrie. Sans doute, le travail d’inculcation par le « haut », voire d’endoctrinement, dans l’Ecole, d’une mémoire collective, en promouvant, en sélectionnant et en légitimant un savoir idoine à la construction d’un espace opératoire au « vouloir vivre collectif », correspond-il à une œuvre de réduction des «indigènes», constitués de populations conquises à l’intérieur comme à l’extérieur et toujours «figures de la barbarie», à une centralité française, conçue comme archétype du Centre (Etat / République / marché) assujettissant les périphéries (peuples, cultures, ethnies, société civile). En ce sens, l’histoire de la colonisation qui coïncide historiquement avec l’invention de l’Ecole laïque, obligatoire et républicaine, n’est pas fortuite en même temps qu’elle relève du caractère idéologique de l’Etat éducateur. Logique marchande et rationalité politique donnent sens au même projet. La colonisation des territoires et des populations s’est accompagnée de la colonisation des «esprits», sous l’étendard de l’Ecole. Un rapport «colonial» au savoir légitime peut ainsi être postulé polito-genèse de l’Ecole, instance de violence symbolique, de légitimation d’un ordre économique et politique souverain et de domination. La violence de l’Etat opère toujours contre la socialité de la société. La construction d’un modèle d’intelligibilité de la légitimation par l’Ecole, dans son travail de recomposition / sélection / production de la mémoire collective suppose l’émergence, la diffusion, la construction d’un savoir, d’un texte caché uniquement accessible par le truchement de clercs autorisés: les instituteurs. Eric Savarese, analyse l’histoire coloniale enseignée, dont la diffusion sous l’effet de la scolarisation obligatoire lui paraît être gage d’efficacité politique, grâce à la construction d’un imaginaire colonial [10] – pensé à la fois comme instrument de connaissance et outil de méconnaissance du fait colonial –. Elle véhicule selon lui, des phénomènes de domination et de légitimation d’un ordre politique et économique nouveau, qui œuvre à la réduction de l’Autre au Même, à l’abolition de l’altérité, par « oubli » des « indigènes ». Savarese précise qu’il n’est pas illégitime de supposer que pensée comme trajet imaginaire, la légitimation des conquêtes coloniales soit avant tout oubli, amnésie. Oubli progressif – à travers l’exercice du pouvoir colonial – de l’Autre, des indigènes, des populations soumises, donc des représentations qui préexistent à la conquête. Amnésie lentement réalisée dans le cadre de rationalisations de colonisateurs qui, élaborant la mythologie de leur pratique coloniale, deviennent les agents de la légitimation de la colonisation et les agents de la colonisation des esprits, par l’Ecole ! Ce qui permet de comprendre l’élaboration de la relation politique de domination, dans la colonisation comme dans l’Ecole, en tant que récit construit/reconstruit d’une œuvre coloniale française, présentée d’une manière euphémisée, unanimiste et invariante dans les manuels scolaires et, au-delà, dans les pratiques de ses acteurs. Aussi, idéologie coloniale, telle qu’elle fut élaborée par les auteurs français est le plus souvent construite à partir de références laïques, et parfois même de concepts inspirés des lumières et de la Révolution Française. L’œuvre coloniale y devient comme preuve de la générosité de la France. Explications rationnelles et messianiques caractérisent tout au long de la IIIème République, une manière moniste de penser la colonisation. Ce que le texte suivant de Lavisse illustre exemplairement:
«L’instituteur et l’institutrice sont des Français. Ils enseignent aux petits Français et aux petits Arabes tout ce que vous apprenez à l’école. Les arabes sont de bons petits écoliers. Ils apprennent aussi bien que les petits Français. Ils font d’aussi bons devoirs. La France veut que les petits Arabes soient aussi bien instruits que les petits Français. Cela prouve que notre France est bonne et généreuse pour les peuples qu’elle a soumis» p. 165.
Après 1962, de longs silences sur l’histoire coloniale vont supplanter le récit patriotique et enthousiaste des conquêtes. Il faudra attendre les années 1980, pour que soit mentionnée la bataille de Dien Bien Phû… C’est dire ô combien la « civilisation » des indigènes par l’éducation aura été le meilleur argument pour justifier la conquête. D’abord parce qu’elle aura été productrice de configurations mentales favorables « au sens de l’histoire » ; ensuite, parce que le travail de reconstruction opéré par l’Ecole, tant dans la sélection du savoir légitime que dans la production d’une mémoire collective acceptable, sert le besoin de naturaliser les phénomènes de domination en jeux, c’est-à-dire de les oublier, car le pouvoir « avance » toujours masqué. Sophie Ernst [4] aborde la question de l’enseignement de l’histoire des mémoires de l’immigration dans le modèle français d’assimilation, celle de la construction par l’école d’une mémoire commune à travers l’identification à des figures de l'histoire, de la géographie ou de la littérature, transmettant un attachement au passé national, fonctionnant sur un mode filial qui avaient pour vocation de transformer en une génération des enfants d’immigrés en français. Mais cela avait un prix, précise-t-elle qui était l’impossibilité de se représenter comment, si l’on était français et gaulois à l’école, on avait des parents bizarres, parlant une langue barbare et ignorants des références communes puisque notre mémoire nationale s’est construite en occultant dans l’imaginaire national le fait de l’immigration. Comme le dit avec pertinence Sophie Ernst, mémoire n’est pas histoire et c’est bien là l’ambiguïté des fonctions de l’Ecole qui oscille entre la transmission de savoirs objectifs et la construction d‘une mémoire commune.
Il n’est pas étonnant que le parlement ait proposée par la loi du 23 février 2005 un article qui supposait que soit enseigné «le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord », avant que cet article ne soit retiré de la loi, face au tollé des historiens notamment.
Cependant, l’intérêt jamais démenti pour les enseignements de civilité (l’ECJS en lycée aujourd’hui) atteste d’arrières pensées toujours possibles en termes de formatage. Le retour à l’instruction civique et morale à l’école primaire scelle notre nostalgie de l’école du passé.
2.2. L’Ecole et la pluralité des cultures
Si l’École peut-elle être conçue comme lieu de production et de reproduction du citoyen, c’est par la transmission des valeurs communes que doivent s’intégrer les milieux dans le lieu et par la production de l’excellence scolaire par le lieu que se différencient les milieux dans le lieu. L’École, milieu moral organisé, façonne l’identité de l’élève en inculquant collectivement et individuellement, des valeurs, normes, conduites et idées communes. Socialiser c’est à la fois convertir et incorporer des structures afin de transformer un être, supposé non social, en un sujet social par une action sur le savoir-être. Le projet fondateur de l’École reposait donc une visée socialisante et unificatrice. Les Pères de la République assignèrent à l’enseignement de l’histoire un objectif patriotique : à tous les enfants aux mille parlers locaux, seraient inculqués l’amour de la patrie une et indivisible et la croyance en la supériorité de la France. L’École républicaine insérée dans un processus de civilisation cohérent parvenait ainsi à maîtriser le travail de subjectivation populaire par la construction de ce sujet social à la fois abstrait et universel, conforme à l’idéal de la science positiviste et de la citoyenneté républicaine. Le petit breton, le petit provençal, le petit corse y perdait sa langue, mais devenait patriote. Par le fonctionnement en apparence uniforme de l’École, par la construction légitimée et légitimante de l’excellence scolaire, l’École construit une représentation officielle de la valeur scolaire des élèves par delà leurs milieux d’appartenance. Mieux encore, elle fait comme si leurs milieux d’appartenance étaient transcendés par le lieu de l’institution. Or, Les visées stratégiques familiales par rapport à l’École, les inégalités de capitaux mobilisables selon les milieux se ramifient avec l’insertion différentielle des familles dans des réseaux professionnels, culturels, associatifs ou politiques. L’existence ou non de projets scolaires familiaux s’accompagnent aussi d’une division du travail école / famille très différente selon les milieux d’appartenance tout comme les relations - leur fréquence et leur forme - entre les parents et les enseignants.
La neutralisation des milieux en un lieu d’intégration des individus autour de valeurs centrales de cohésion suppose d’assigner au système scolaire la vocation de former le citoyen couplé aujourd’hui avec l’ambition de former l’agent économique. Le système scolaire est supposé vecteur d’ascension sociale possible et agent de socialisation par excellence. Si les programmes scolaires du début du siècle sont explicitement truffés d’intentions morales, ceux d’aujourd’hui fonctionnent implicitement de la même manière. Mais ce travail d’acculturation à l’œuvre dans les pratiques scolaires est aujourd’hui en crise.L’Ecole républicaine, telle qu’elle a participé à construire la République était fondée sur la promotion d’un idéal d’égalité des chances dont le socle reposait sur un projet d’inculcation d’une mémoire et d’une culture communes. La République moniste construisit par le système scolaire une solution originale, sorte d’allégeance des périphéries au centre. La centralité revendiquée de la citoyenneté dans le cas français conduit non seulement à une sous-estimation de la vitalité des appartenances singulières et collectives, mais aussi à la construction d’un habitus nationaliste républicain tendant à mettre hors-jeu tout autre mode d’identification. Avec la chute de l’empire et les vagues d’immigration successives, la légitimité sociale et culturelle de ce système est aujourd’hui révoquée en doute. L’Ecole doit-elle, peut-elle détribaliser ?
Soumis aux enjeux économiques et aux injonctions politiques, le lien social est en perpétuelle construction/ déconstruction et l’Ecole dans nos sociétés, est au centre d‘un processus de tissage des solidarités et des singularités multiples, mais aussi au cœur de la construction de formes de dominations et d’allégeances. Si l'Ecole participe à la construction politique du sens, entre unité et diversité, c’est au travers de la promotion d’une cité laïque, politiquement correcte en ce qu’elle neutralise en apparence les aspérités tant ethniques, sociales, culturelles, régionales que confessionnelles, dans un espace supposé homogénéisant – bien que jamais homogène – les singularités individuelles et les particularismes communautaires. Or, elle est aujourd'hui confrontée à une demande croissante de pluralismes cultuels et culturels. Ainsi par exemple, certaines jeunes filles musulmanes veulent porter le voile à l'Ecole, des élèves font ramadan et les cantines s’adaptent aux interdits alimentaires. Certains étudiants juifs refusent les examens pendant shabbat. Mais aussi des jeunes revendiquent et organisent de nouvelles formes de socialisation et de sociabilité radicalement allogènes au monde scolaire, émergence de nouvelles tribus, voire de nouveaux « mondes scolaires ».
Les revendications récentes de promotion des cultures et des langues régionales, des Bretons, des Corses, des Basques ou des Calédoniens, si elles ont d’abord investi les écoles privées, s’expriment au sein même de l’espace éducatif public. Les solidarités mécaniques de proximité (de village, de clan, de familles, de cultures communes, de régions) que la modernité triomphante paraissait avoir laminées, que la violence symbolique de l'Etat centralisateur pensait avoir réduit au silence dans l'acculturation à la citoyenneté moniste, resurgissent avec la crise de la raison. La citoyenneté devient plurielle. Or, la centralité de notre noyau citoyen, tient à ce qu’elle s’est construite comme mode d’appartenance en rupture avec les autres formes d’allégeance qu’elles soient locales, parochiales, claniques. La citoyenneté relègue les solidarités mécaniques à la sphère du culturel et non du politique, à la sphère de l’intimité et non du public. En tant que déni des allégeances particulières, qu’elles soient infra ou supranationales d’une part ou économiques et sociales d’autre part, la citoyenneté fut ce projet politique fondateur, vécu comme forme quasi-naturalisée d’appartenance qui construit un sujet politique unidimensionnel. De fait, elle rejette au périphérique ce qui dans les singularités renvoie aux groupes de référence et reconstruit le pluriel comme une unité totalisante et auto légitimante.
Le travail d’acculturation de l’institution est-il caduc : le grand débat comme révélateur ….
La laïcité corrélée au projet méritocratique a été l'instrument de construction politique de notre citoyenneté, le cadre juridique et politique de l’invention d’une « mêmeté » au fondement de la Nation. Il y a un lien historique, voire nécessaire, entre République et laïcité puisque cette dernière abusivement saisie comme neutralité politique (autant que religieuse) engendre un déni du politique dans le lieu scolaire. L’idéologie sous-jacente à la laïcité au sens de perspective sous laquelle le sujet se représente ses valeurs, ses normes et les fins posées par sa société, en est le laïcisme qui figure au cœur de la concurrence opposant, au dix-neuvième siècle, les mondes religieux et politique quant au monopole du discours de légitimité sur le monde. Dans ce contexte, le laïcisme fut à la République ce que le scientisme fut à la science. Le modèle de laïcité à la française, qui est pourtant une exception politique, nous semble aller de soi s’il n’est pas réfléchi et déconstruit de manière critique, parce qu’imposé comme cadre de la réduction d’une espérance démocratique dans l’institution d’une république moniste. Aujourd’hui encore, pour nombre de zélateurs d’une conception neutralisante de la laïcité, tout se passe comme si elle s’était imposée en tant qu’évidence d’autant mieux partagée que chacun la définit à sa manière. Or, la laïcité, œuvre de compromis de la IIIème République, n’est pas tant une articulation des activités privées et publiques à l’Ecole, une éviction des religions dans l’école ou une neutralité religieuse et d’opinions revendiquées, qu’un modèle politique d'imposition et de légitimation d'un ordre social supposé pacifié, conçu comme emblème de la conception républicaine de l’espace public. S’il est historiquement anachronique d'assimiler laïcité et neutralité politique, c’est au prix d’une méconnaissance du sens originel du projet de laïcisation des savoirs.
La laïcité, résultat d’un conflit au cours duquel l’Etat s’est émancipé de l’institution religieuse dans l'esprit de Jules Ferry et des créateurs de l'école républicaine, n'est pas synonyme de neutralité politique, mais de neutralité religieuse, même si le modèle fondateur de la laïcité a des fondements quasi-religieux dans la sacralisation du savoir (particulièrement du rapport au savoir abstrait) supposée être gage d'une morale laïque et commune à transmettre. Historiquement, cette idéologie était très engagée politiquement puisqu'il s'agissait d'inculquer la Patrie (son amour) et la République (sa suprématie). Il fallait construire la République par l’Ecole. Aujourd’hui, la laïcité renvoie plutôt à une « anti-idéologie » (dans la mesure où elle est présentée comme une garantie d’objectivité de l’enseignement dispensé), même si cela ne va pas sans occasionner des effets pervers. La laïcité est devenue (sous couvert de respect des opinions ou d’apolitisme) un prétexte pour oblitérer toute prise en compte explicite des valeurs. Ce n'est probablement qu'après mai 68, dans un climat « droitier » d'imputation de «gauchisme» au corps enseignant, d'un fantasme d'endoctrinement politique des masses par l'école, qu'une circulaire d'Haby identifie laïcité et neutralité politique et scelle le glissement sémantique, alors même que pour les pères fondateurs de la réplique, la laïcité est un instrument politique de régénération de la Nation et assumé comme tel. En gommant les caractéristiques relevant des champs religieux et politique, l’idée de laïcité conduirait, au nom d’une supposée neutralité, à l’occultation des débats autour d’enjeux sociaux ou politiques, par exemple enseigner le fait religieux. Finalement, la laïcité telle que définie, comme exclusion du religieux et comme neutralité politique, en tant que norme centrale de cohésion de l'institution scolaire, sert de socle idéologique, pour faire tenir ensemble ce qui est désuni, par delà les clivages sociaux, culturels, cultuels et même de genres, au travers aujourd’hui de l’interdit posé au port du voile. A travers le traitement public de la question du « voile » à l’Ecole, se donne à voir une culture laïque dominante. Dans la lignée du rapport Stasi en 2003, la loi du 15 mars 2004 interdit en effet le port de signes religieux « ostensibles » à l'école. L'Ecole du pluriel confrontée aux nouvelles demandes des mouvements religieux, aux résurgences des minorités culturelles et cultuelles, ne peut plus être cette école républicaine façonnant l’imaginaire collectif autour du déni du Politique, promotrice de l’idéal messianique positiviste et laïque. L’argument de « laïcité » demeure cependant récurrent dans l’imaginaire politique. Il reste à en décrypter les bénéfices symboliques, politiques et identitaires paradoxalement inscrits dans l’ordre des discours et des pratiques d’exclusion, même s’ils sont officiellement connotés comme gages d’une universalité accueillante, bienveillante et « incluante ».
Ainsi s’il existe une exception française, c’est celle de la confusion entretenue par l’appareil d’Etat entre le politique et le religieux, assurant la promotion d’une séparation posant l’Etat comme extérieur aux Eglises, alors même que selon lui, ce discours sert à justifier (et à masquer) les interventions étatiques sur le religieux. La laïcité est à concevoir comme cette confusion non assumée, entre le politique et le religieux, assise sur de prétendues valeurs républicaines universalistes, proclamant la neutralité politique de l’Etat vis-à-vis du religieux. Il s’agit d’une forme de neutralité à l’origine de l’action publique, tout en déniant l’existence même d’actions étatiques dans les affaires religieuses. Sous cet éclairage, la laïcité est une idéologie (et pas seulement le laïcisme) qui sert le projet de construire publiquement les problèmes religieux, érigés en problèmes socioculturels (donc à intervenir pour en solutionner certaines manifestions jugées incompatibles avec les intérêts dominants du moment, contrairement au postulat de neutralité). La question du « voile » à l’Ecole en donne une illustration. Celle d’une culture laïque dominante fixant un interdit en forme d’oppositions (et d’impositions) irréductibles de valeurs (républicaines versus islamistes). Un impensé de la laïcité est ici posé à partir du jeu des impositions de normes implicites de recevabilité dans l’ordre républicain, national et citoyen (donc aussi dans l’ordre scolaire qui en reflète les valeurs et en précise certains moyens), en termes de pratiques arbitraires, discriminantes et au final, excluantes. Le statut des minorités visibles (et plus généralement de la visibilité), revendiquant, y compris de manière ostentatoire leur droit à la visibilité dans l’Ecole républicaine, achoppe sur la règle laïque posée en tant qu’interdit de visibilité des corps, d’abord dans ce qu’ils renvoient à une propriété privée – y compris dans la négation d’une visibilité des genres dans la relation aux savoirs – ensuite en ce qu’ils prescrivent la promotion d’une invisibilité comparable dans l’ordre économique marchand à celle de la transparence. La problématique politique du voile à l’Ecole relève selon nous d’un travail de dévoilement d’un sens caché: de ce qui est à la fois caché et montré, du corps comme de la violence de la règle, a fortiori, de l’instrumentation faite aux corps par la règle laïque. Il convient en cela d’interroger la laïcité (comme la démocratie, la république ou la citoyenneté d’ailleurs) en tant que lieu et moment d’un espace narratif, l’espace de la locution (« la machinerie esthétique de la domination sociale» [8]), du locus qui dit, interdit, prescrit, tait quelque chose sur nous-mêmes, l’arrière-plan de nos pensées, nos difficultés aussi à penser nos impensés.
La laïcité est à la fois regard (voilé) sur nous-mêmes et sur l’Autre, sur le corps de l’Autre, son apparence, ses différences plus ou moins acceptables, y compris son apparence de genre. L’Ecole moniste, toujours à la recherche de la meilleure voie pour transmettre la connaissance utile, l’amour et le respect de la règle, tous subordonnés à cette condition de dépossession d’un droit de propriété privé à l’usage des corps (au bénéfice exclusif de la promotion d’un corps collectif, abstrait et « publicisé »), prétend ériger une forme de visibilité paradoxale puisque « neutralisée » dans sa représentation individuelle, par l’interdit réaffirmé de l’existence d’un signe corporel dans l’espace scolaire, dont la vertu et le danger consistent à réintroduire symboliquement les corps absents / présents dans la relation scolaire, c’est-à-dire supposés préalablement neutralisés par la règle laïque et ses interdits. Elle impose des règles disciplinaires, par nature violentes, au travers d’injonctions de posture, de présentation de soi, de bonne gestion corporelle, de « visibilité ». A ce titre, la règle laïque participe à un travail de surveillance des corps et des esprits. Y a-t-il une place pour les corps (spécialement s’ils sont rebelles ou suspectés de l’être) dans l’Ecole laïque républicaine et les corps y sont-ils à leur place assignée par l’institution ? Est-il possible (pensable) de laisser faire le corps ? Peut-il, « voilé » ou muni d’un signe ostentatoire, passer (rester) dans « le corps » de l’Ecole ? L’Ecole peut-elle être autre chose que ce lieu de régulation et de contrôle des conduites corporelles que la laïcité permet de sanctionner et de légitimer ? Dans l’Ecole les corps sont individualisés. Ils doivent être vus, sous le regard des observateurs ; corps dévoilés par la laïcité au bénéfice d’une espérance collective de conquête et de domination des corps privés (privés symboliquement de corps…) pour satisfaire au projet de « mêmeté », figure centrifuge d’un possible Être-ensemble, mais excluant, ce faisant, tout manifestation et signe de reconnaissance d’une altérité en genre (le port du voile), rendue d’autant plus visible que le signe (le voile) dévoile alors justement et en contradiction avec la neutralisation laïque des corps, une différence saisie comme contradiction au procès de « mêmeté ».
En instaurant un régime de valeurs adéquates au projet républicain, conformes aux nécessités de la rationalité marchande et de l’insertion économique, cette scolarisation obligatoire, au contact de la morale civique et des valeurs bourgeoises, était en passe de créer les conditions objectives et subjectives d’adhésion à un imaginaire national raisonné (et arraisonné), dont la fin serait la désignation d’une civilisation héroïque et au surplus exportable dans les termes de la colonisation et de l’universalisme, en instituant un sens au « sens de l’histoire ». Morale et instruction civique sont une tradition de l’école républicaine française. Elles forment au « catéchisme républicain » et concentrent l’action éducative sur un savoir-être commun. Si elles ont été déclinées, au fil du temps, en éducation civique et citoyenne ou en éducation civique juridique et sociale (ECJS), elles ont même été pensées en complément des enseignements de « société », tels que l’histoire-géographie ou les sciences économiques et sociales, y compris dans le cadre d’une option de spécialité au lycée, à partir d’une formation plus approfondie en science politique. Quelle place aujourd’hui pour la pluralité des valeurs à l’école ? Au normativisme des premiers temps de l’école obligatoire fait place le règne du relativisme des valeurs. L’école « désenchantée » ploie sous des valeurs plurielles et parfois contradictoires : progrès, culture, finalités, comportements, institutions, méritocratie, utilitarisme signalent le pluralisme des valeurs. Le trop plein des valeurs produites et échangées pose problème dans un contexte toujours plus favorable à la marchandisation de l’éducation. L’école est, moins que par le passé, en mesure de porter les valeurs démocratiques qui la justifie, dans un climat où les idéaux démocratiques semblent moins établis dans leurs classiques dimensions citoyennes et de socialisation au politique, au profit notamment du règne du consommateur. Houssaye l’exprime sans détour :
« (…) Que ce soit par rétention de valeurs exprimées ou par imposition de valeurs restreintes, la laïcité n’interdit-elle pas toute éducation aux valeurs ? Du même coup, la laïcité n’est-elle pas opposée à la sécularisation ? Auquel cas, elle se disqualifierait comme cadre institutionnel permettant de penser toute éducation aux valeurs à l’école. Voici donc la laïcité confrontée au pluralisme des valeurs : qu’en fait-elle ? qu’en dit-elle ? » (Les valeurs à l’école. L’éducation aux temps de la sécularisation, PUF, 1992, p. 225)
A société tribalisée, selon l’hypothèse de Maffesoli, répondent des valeurs nomades, traversant l’école à l’ère de la massification scolaire, elle-même gestionnaire de publics hétérogènes à la fois culturellement, socialement, voire ethniquement. La mise en échec du système scolaire tient aussi au déclin des anciens consensus scolaires : méritocratie, égalité des chances, promotion sociale par la possession de diplômes sont à la fois moins opératoires et moins assurées que par le passé dans un contexte de massification et de consumérisme scolaires. Car, c’est au cœur de la fonction la plus éminente de toute institution, et particulièrement de l’institution scolaire, que les failles et les doutes apparaissent, sur le fait même de pouvoir s’interroger sur ses capacités à toujours décréter l’identité. Comme l’explique Mary Douglas dans Comment pensent les institutions,
« Le processus cognitif fonde l’institution à la fois en nature et en raison. (…) Le rapport de similarité est une institution (…), (à partir duquel l’individu tire avantage) à rallier le fonctionnement collectif des analogies fondatrices » (p. 73).
En conséquence, les institutions sont supposées conférer l’identité, ce qui justifie leur permanence. Si elles n’y parviennent plus, où si elles y parviennent moins, probablement parce l’apport récent des minorités ethno-religieuses à l’identité nationale n’est pas pensé, la question d’une crise de l’Ecole se pose alors en termes de difficultés et d’obstacles aux ralliements attendus, d’intérêts ou pas à partager les analogies fondatrices, confrontées notamment à la montée de nouveaux « mondes scolaires » à l’ère de l’identité plurielle et métissée et de l’hétérogénéité croissante des socialisations. L’éclatement des formes identitaires au système scolaire rompt le pacte fondateur de l’Ecole républicaine inscrit dans la neutralisation des milieux (sociaux, économiques, culturels, ethniques) dans et par un lieu homogénéisant, celui de l’Ecole. A partir d’un éclatement des sociabilités juvéniles, une recomposition constante des milieux au lieu s’opère aujourd’hui par l’invention des mondes scolaires et signale l’entrée dans le temps du multiple ou du pluriel. La diversification croissante des référents identitaires des jeunes renvoie au déclin des régulations politiques des institutions traditionnelles (de la famille en passant par l’Ecole ou la Nation), recomposant le maillage des liens organiques, mécaniques et symboliques tissés entre institutions de l’espace public et de l’espace privé. La nouvelle ère de l’individualisation, dont les principaux marqueurs sont la société de consommation, la mondialisation, les institutions bureaucratiques désocialisantes, les métamorphoses de la famille ou encore la recomposition du religieux, est l’indice d’un affaiblissement du lien social et un vecteur de résurgences des solidarités mécaniques de type communautaires. Ces transformations jalonnent l’effritement des mécanismes d’intégration autour des valeurs centrales, anciennement incontestées, et résultant toujours d’un travail d’imposition hégémonique. La massification du système scolaire et l’explosion des sociabilités / socialités juvéniles confrontent alors une Ecole à vocation homogénéisante, à la nécessaire gestion du pluriel et produisent une fragmentation des modes d’insertion des élèves à l’institution scolaire, dans une Ecole fragilisée et contestée par le retour des milieux. L’Ecole en crise est alors cette école « désenchantée », confrontée à l’éclatement des cultures scolaires. Le contrôle social assuré anciennement par l’Ecole est en butte à des résistances toujours plus affirmées à partir de sous-cultures juvéniles majoritairement ignorées par l’Ecole et stigmatisées en tant que cultures périphériques ; celles-ci n’ont pas leur place Entre les murs d’une Ecole aux fortifications effritées. Avec les mutations de l’Ecole et avec celles de la vie adolescente, la signification subjective des activités scolaires s’est diversifiée, au point que tous les allant de soi de la relation pédagogique et de la relation des élèves à l’institution se sont dissous. Pour de nombreux publics, la vie juvénile acquiert une autonomie croissante à la famille, à l’Ecole et aux agents traditionnels de la socialisation. Souvent les cultures juvéniles se définissent contre la culture scolaire. Dominique Pasquier dans son ouvrage « Cultures lycéennes » conclut que « chez les lycéens, la culture dominante n'est pas la culture de la classe dominante mais la culture populaire ». La fracture scolaire, relayant la fracture ethnique, fait effraction dans notre mode de pensée. Elle a valeur de « trauma » pour le modèle républicain, jamais réfléchi car vécu comme universel et universalisable. Pourtant l'universalité est aussi une construction sociale. Mais si les sociétés se font elles-mêmes - tel est le credo fondateur - elles utilisent mille détours pour se dérober à elles-mêmes dans un double mouvement de simulation / dissimulation. Face à l’inquiétante étrangeté des « incasables », selon l’expression de Jacques Selosse [11], souvent décrits sans repères – alors que le sociologue Daniel Thin [12] montre que ce sont plutôt dans les familles populaires une conception de l’autorité très différente de l‘autorité légitime que l'institution scolaire demande –, les discours communs et médiatiques sur l’Ecole relayent une nostalgie qu’il nous faut penser. « Fabrique de crétins » : la formule, signée, Jean-Paul Brighelli est une sorte de bannière pour tous les déçus de l’Ecole dans une république assimilationniste, sorte d e machine à phagocyter les différences ….
Inlassablement l’Etat n’a de cesse de produire une citoyenneté nationale productrice d’identité collective : « L'âme d'une nation ne se conserve pas sans un collège officiellement chargé de la garder » écrivait Ernest Renan. L’identité nationale se décrète-elle ? L’identité nationale s’enseigne telle dans des cours d’instruction civique à l’école ou dans els préfectures ? Peut-elle se réduire à une mémoire tronquée et excluant dans une école qui au lieu d’inclure, en donnant à tous conditions d’une participation républicaine choisit exclusion systématique des distinctions trop « ostensibles », au moment même où il devient clair pour chacun que les populations musulmanes essentiellement d’origine maghrébine non seulement sont durablement installées, ont des velléités d’intégration et d’ascension sociales, et que leurs enfants sont ou seront français, citoyens français dans le même temps où l'inégalité de traitement des différents cultes se traduit même dans les discours. Dans son discours à St Jean de Latran du 20 déc. 2007, le président N. Sarkozy s’exprime ainsi : «Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé (souligné par nous ) … parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance. »
La circulaire du 22 mai 2004 concernant le port de signes religieux à l’Ecole souligne ( : p. 1, fin 5ème §) : « ... si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique »
Aucune question ne doit être exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique, même celle de l‘identité nationale est scolairement entretenue.
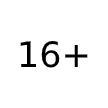

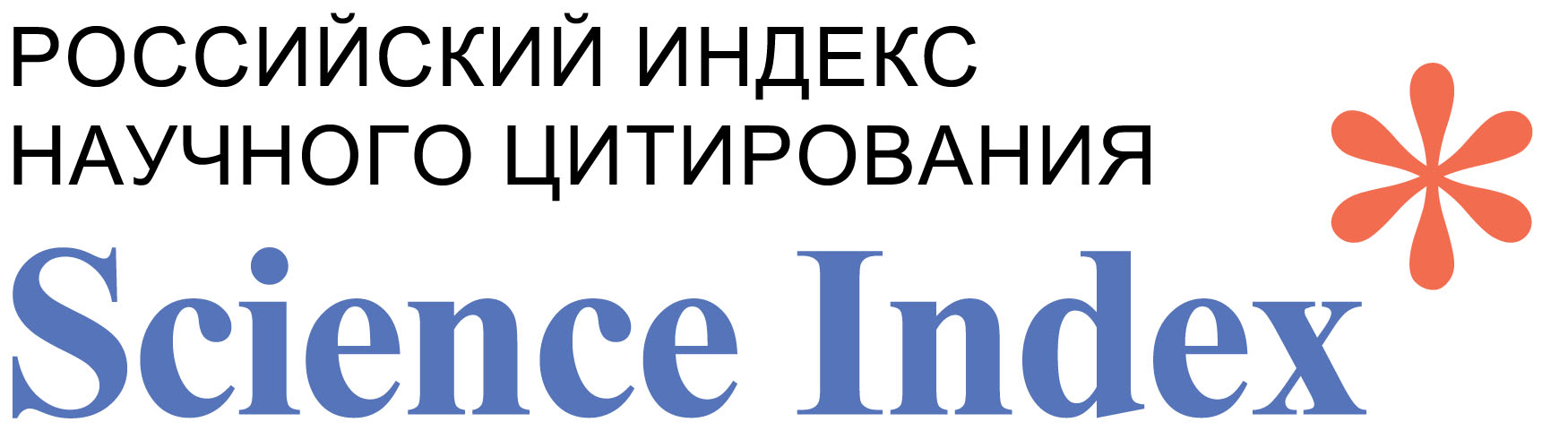




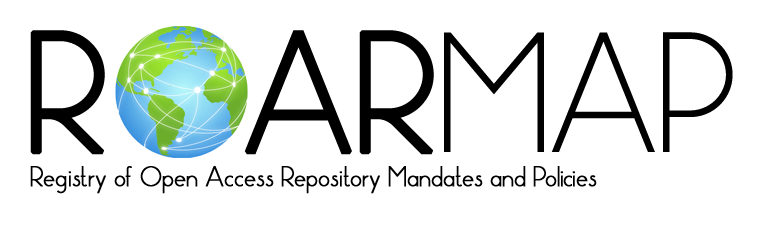

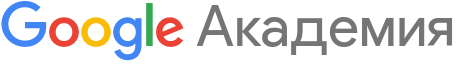


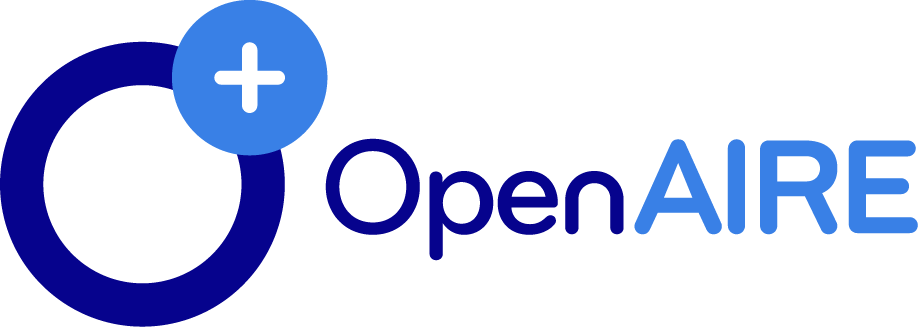




Список литературы